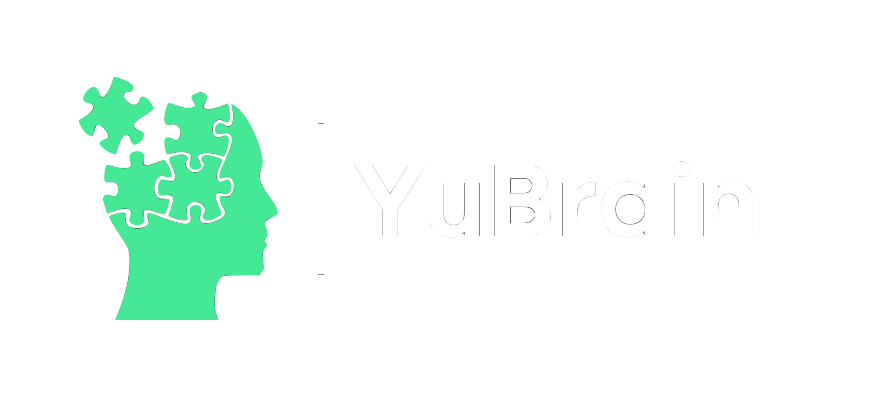Tabla de Contenidos
L’anthropologue Charles Frake a défini l’écologie culturelle en 1962 comme l’étude du rôle de la culture en tant que composante dynamique de tout écosystème , définition qui reste d’actualité. Entre un tiers et la moitié de la surface terrestre a été modifiée par les activités humaines. L’écologie culturelle considère que les êtres humains étaient intrinsèquement liés aux processus qui se déroulent à la surface de la terre bien avant que les développements technologiques ne permettent de les modifier à grande échelle.
Le contraste entre la vision précédente et la vision actuelle de l’écologie culturelle peut être illustré par deux concepts opposés : l’impact humain et le paysage culturel. Dans les années 1970, les racines du mouvement écologiste se sont développées par souci de l’impact humain sur l’environnement. Mais elle diffère de la conception de l’écologie culturelle en ce qu’elle place les êtres humains hors de l’environnement. Les êtres humains font partie de l’environnement, pas une force extérieure qui le modifie. Le terme paysage culturel, c’est-à-dire les personnes et leur environnement, conçoit la Terre comme le produit de processus bioculturels interactifs.
écologie culturelle
L’écologie culturelle fait partie de l’ensemble des théories qui composent les sciences sociales de l’environnement et qui fournissent aux anthropologues, archéologues, géographes, historiens et autres chercheurs et éducateurs un cadre conceptuel sur les raisons pour lesquelles les gens agissent.
L’écologie culturelle est intégrée à l’écologie humaine, qui distingue deux aspects : l’écologie biologique humaine, qui traite de l’adaptation des personnes à travers des processus biologiques ; et l’écologie culturelle humaine, qui étudie comment les gens s’adaptent en utilisant des formes culturelles.
Considérée comme l’étude de l’interaction entre les êtres vivants et leur environnement, l’écologie culturelle est associée à la façon dont les gens perçoivent l’environnement ; elle est également associée à l’impact des êtres humains, parfois imperceptible, sur l’environnement, et vice versa. L’écologie culturelle concerne les êtres humains : ce que nous sommes et ce que nous faisons en tant qu’organisme de plus sur la planète.
adaptation à l’environnement
L’écologie culturelle étudie les processus d’adaptation à l’environnement, c’est-à-dire comment les gens se rapportent à, modifient et sont affectés par leur environnement changeant. Ces études sont d’une grande importance car elles abordent des problématiques telles que la déforestation, la disparition d’espèces, les pénuries alimentaires ou la dégradation des sols. Connaître les processus d’adaptation que l’humanité a traversés peut aider, par exemple, à envisager des alternatives pour faire face aux effets du réchauffement climatique.
L’écologie humaine étudie le comment et le pourquoi des processus par lesquels différentes cultures ont résolu leurs problèmes de subsistance ; comment les gens perçoivent leur environnement et comment ils préservent et partagent ces connaissances. L’écologie culturelle accorde une attention particulière aux connaissances traditionnelles sur la façon dont nous nous intégrons à l’environnement.
La complexité du développement humain
Le développement de l’écologie culturelle en tant que théorie a commencé avec la tentative de comprendre l’évolution culturelle, avec la théorie de l’évolution culturelle dite unilinéaire. Cette théorie, développée à la fin du XIXe siècle, postulait que toutes les cultures se développaient selon une progression linéaire : la sauvagerie, définie comme une société de chasseurs-cueilleurs ; la barbarie, qui a été l’évolution vers les bergers et les premiers agriculteurs ; et la civilisation, caractérisée par le développement d’aspects tels que l’écriture, le calendrier et la métallurgie.
Au fur et à mesure que les investigations archéologiques progressaient et que les techniques de datation se développaient, il est devenu clair que le développement des civilisations anciennes n’obéissait pas à des processus linéaires avec des règles simples. Certaines cultures ont oscillé entre des formes de subsistance basées sur l’agriculture et celles basées sur la chasse et la cueillette, ou les ont combinées. Les sociétés qui n’avaient pas d’alphabet avaient une sorte de calendrier. Il a été constaté que l’évolution culturelle n’était pas unilinéaire mais que les sociétés se développaient de nombreuses manières différentes; en d’autres termes, l’évolution culturelle est multilinéaire.
déterminisme environnemental
La reconnaissance de la complexité des processus de développement des sociétés et de la multilinéarité du changement culturel a conduit à une théorie sur l’interaction entre les personnes et leur environnement : le déterminisme environnemental. Cette théorie établit que l’environnement de chaque groupe humain détermine les modes de subsistance qu’il développe, ainsi que la structure sociale du groupe humain. L’environnement social peut changer et les groupes humains prennent des décisions sur la façon de s’adapter à la nouvelle situation en fonction de leurs expériences réussies et frustrantes. Les travaux de l’anthropologue américain Julian Steward ont jeté les bases de l’écologie culturelle ; C’est aussi lui qui a inventé le nom de la discipline.
L’évolution de l’écologie culturelle
La structuration moderne de l’écologie culturelle est basée sur l’école matérialiste des années 1960 et 1970 et intègre des éléments de disciplines telles que l’écologie historique, l’écologie politique, le postmodernisme ou le matérialisme culturel. En bref, l’écologie culturelle est une méthodologie d’analyse de la réalité.
Sources
Berry, JW Une écologie culturelle du comportement social . Avancées en psychologie sociale expérimentale. Edité par Léonard Berkowitz. Academic Press Volume 12 : 177–206, 1979.
Frake, Charles O. Écologie culturelle et ethnographie. Anthropologue américain 64 (1): 53–59, 1962.
Chef, Lesley, Atchison, Jennifer. Écologie culturelle : nouvelles géographies homme-plante . Progrès en géographie humaine 33 (2): 236-245, 2009.
Sutton, Mark Q, Anderson, EN Introduction à l’écologie culturelle. Éditeur Maryland Lanham. Deuxième édition. Presse Altamira, 2013.
Montagud Rubio, N. L’écologie culturelle : qu’est-ce que c’est, ce qu’elle étudie et les méthodes de recherche . Psychologie et esprit.