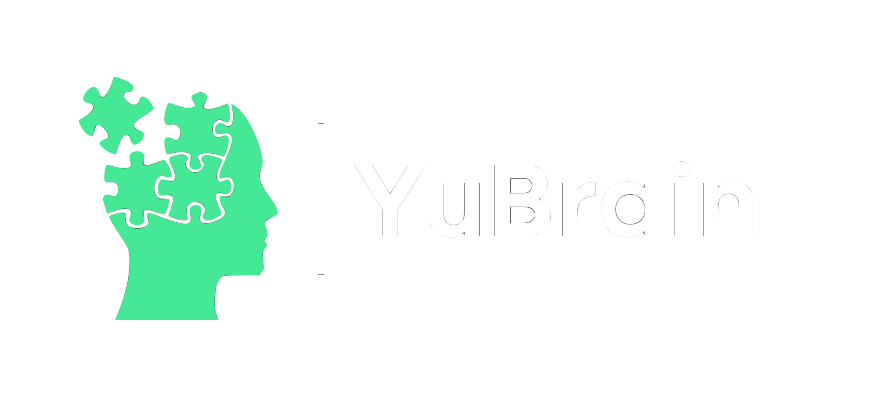Tabla de Contenidos
Les stomates sont des structures ou petits pores (ostioles) situés dans l’épiderme (tissu externe) des plantes, souvent sur la face inférieure des feuilles, c’est-à-dire dans la partie inférieure de la feuille, et qui permettent l’échange de gaz entre la plante et l’environnement. Les cellules épidermiques végétales sont normalement épaisses et allongées, et leur continuité est interrompue par des stomates, qui peuvent également se trouver n’importe où sur la plante sauf la racine.
L’appareil stomatique
Chaque stomie est à son tour composée d’autres structures et types de cellules pour former l’appareil stomatique. En plus du pore , par lequel des gaz tels que le CO 2 , la vapeur d’eau et l’oxygène entrent et sortent, l’anatomie de la stomie est composée de deux cellules de garde (également appelées cellules de garde) entourées de cellules auxiliaires (également appelées cellules annexes ou compagnes). Le pore et l’ensemble des cellules occlusives et auxiliaires constituent la cavité sous-stomatique (cavité respiratoire de la stomie).
Les stomates sont responsables de nombreux processus physiologiques importants chez les plantes. Par les stomates, le CO 2 entre dans , qui est utilisé comme matière première pour produire des glucides dans le processus de photosynthèse, où l’oxygène est généré comme sous-produit qui est rejeté dans l’atmosphère. Ils ont également un rôle important dans la transpiration de la plante : lorsqu’ils s’ouvrent, un potentiel hydrique est créé qui, à son tour, favorise l’absorption de l’eau par les racines et sa translocation ultérieure vers le reste des organes de la plante.
Classification stomatique
Il existe plusieurs manières de classer les stomates : selon le type de plantes où ils se trouvent, selon leur localisation dans l’épiderme végétal, selon l’origine des cellules qui composent l’appareil stomatique, et selon la présence ou l’absence de cellules. ci-joint.
Par le type de plantes où ils se trouvent . Les stomates des plantes monocotylédones et dicotylédones diffèrent par la forme des cellules de garde. Les stomates des plantes monocotylédones ont des cellules de garde en forme de cloche, tandis que chez les plantes dicotylédones, les deux cellules de garde entourant les stomates sont en forme de haricot.
Selon l’emplacement des stomates dans l’épiderme. Cette classification dépend de la distribution particulière des stomates dans la plante :
- Amphistomatique . Chez les monocotylédones, il est de type amphistomatique, c’est-à-dire qu’ils sont présents dans l’épiderme supérieur (fagot ou face adaxiale de la feuille) et inférieur (face inférieure ou face abaxiale) des feuilles.
- Hypostomatique . Chez les plantes dicotylédones, la distribution est de type hypostomatique, présente dans l’épiderme inférieur (face abaxiale) de la feuille.
- Epistomatique . Il existe une troisième catégorie de distribution des stomates, l’épistomatique qui se produit dans les plantes qui les ont distribués dans l’épiderme adaxial, généralement trouvée dans les plantes aquatiques à feuilles flottantes, comme le nénuphar.
Selon l’origine de toutes les cellules qui composent l’appareil stomatique. C’est une autre façon de regrouper et de classer les stomates :
- Stomie mésogène : Les cellules de garde et les cellules annexes sont issues d’une même cellule par 3 divisions successives. Ce type de stomie ne se trouve pas chez les monocotylédones.
- stomie périgène . La cellule mère n’est à l’origine que des cellules occlusives, les cellules annexées proviennent d’autres cellules protodermiques (cellules qui, une fois différenciées, sont à l’origine de l’épiderme). Ce type de stomie est présent chez les espèces de tous les groupes de plantes vasculaires.
- Stomie mésopérigène : La cellule mère donne naissance aux cellules occlusives et à une cellule annexe, tandis que le reste provient d’autres cellules protodermiques. Ce type de stomie a été trouvé dans tous les groupes de plantes vasculaires.
Selon la présence ou l’absence de cellules attachées, les stomates sont classés comme :
- Stomie anomocytaire : n’a pas de cellules annexes ou auxiliaires.
- Stomie anisocitique : Elles ont trois cellules annexées de taille différente.
- Stomie paracytique – Possède deux cellules annexes disposées avec leur grand axe parallèle au grand axe des cellules de garde.
- Stomie diacitique : elles ont deux cellules attachées disposées avec leur axe longitudinal perpendiculaire à l’axe longitudinal des cellules de garde.
- Stomie tétracytaire – a 4 cellules annexes (auxiliaires) autour des cellules de garde.
- Stomie cyclocytaire – Nombreuses cellules annexées (auxiliaires), disposées en un ou deux cercles autour des cellules de garde.
- Stomie hélicocytaire – avec plusieurs cellules annexes (auxiliaires) disposées en spirale autour des deux cellules de garde.
La position des stomies présente également un intérêt botanique, selon le type d’espèce végétale, elles peuvent être situées en saillie de l’épiderme, au niveau de l’épiderme ou enfoncées dans des cavités spéciales, qui dépendent du type de plante et de l’endroit où il se développe. Chez les plantes mésophytes (celles qui nécessitent un accès à l’eau ou à des environnements avec des températures non extrêmes), les stomates sont généralement au même niveau que les autres cellules. Chez les plantes hygrophytes (plantes aquatiques), les stomates sont surélevés au-dessus des autres cellules (ce qui favorise la transpiration). Les plantes xérophytes (provenant de milieux secs) ont des stomates petits, étroits et enfoncés, et en grande quantité pour favoriser les échanges gazeux lorsque l’apport en eau est favorable,
Conditions environnementales et mécanisme des mouvements stomatiques
Dans des conditions optimales, les stomates sont ouverts, permettant les échanges gazeux avec l’atmosphère. Cependant, il convient de noter que le mécanisme des mouvements stomatiques dépend des modifications de la pression de turgescence des cellules de garde et des cellules épidermiques adjacentes (compagnons). Ces changements de forme lors de l’ouverture ou de la fermeture du pore sont possibles par un mécanisme qui transforme l’amidon contenu dans la cellule en sucre ; une fois que les cellules contiennent une forte concentration de sucres et de sels de potassium, en raison du processus d’osmose, l’eau provenant des cellules attachées s’infiltre et par conséquent les cellules occlusives gonflent, c’est-à-dire qu’elles augmentent de taille. Si, au contraire, les cellules de garde perdent de l’eau, les parois cellulaires se rapprochent l’une de l’autre au centre, fermant l’ouverture ou le pore.
Le mécanisme d’ouverture et de fermeture des pores stomatiques répond aux variations de certains facteurs environnementaux et internes, notamment la lumière, la concentration en CO 2 , le potentiel hydrique des feuilles et la température. L’humidité est un exemple de condition environnementale qui régule l’ouverture ou la fermeture des stomates. Lorsque les conditions d’humidité sont optimales, les stomates sont ouverts, mais lorsque les niveaux d’humidité dans l’air autour des feuilles des plantes diminuent, soit en raison de la hausse des températures ou du vent, les stomates se ferment pour empêcher la transpiration et la perte d’eau excessive. Ce mécanisme des plantes leur permet de réagir rapidement aux changements de l’environnement.
Fonctions de l’appareil stomatique
Les stomates remplissent des fonctions très importantes dans le monde végétal, car à travers eux les plantes absorbent le CO 2 présent dans l’atmosphère et expulsent l’oxygène lors du processus de photosynthèse ; au contraire, dans le processus de respiration, ils absorbent de l’oxygène et rejettent du CO 2 .
L’eau perdue par la plante se produit par le processus de transpiration stomatique, qui domine le contrôle du potentiel hydrique de la plante. Un mécanisme de régulation possédé par les plantes supérieures consiste à maintenir les stomates fermés lorsque l’eau est rare, même lorsqu’elles sont en présence de soleil. Les stomates sont fermés pour éviter la perte d’eau par transpiration, car elle sort sous forme de vapeur d’eau. Pour que cela se produise, les cellules perdent de l’eau, deviennent flasques et le pore se ferme ; En revanche, lorsque les cellules sont pleines d’eau et turgescentes, la paroi mince cède grâce à un mécanisme compliqué faisant intervenir des sucres, des phytohormones, des ions K + et des ions Ca 2+ , et le pore s’ouvre permettant les échanges gazeux.
En revanche, lorsqu’il y a de faibles concentrations de CO 2 dans le mésophylle (le tissu situé entre l’épiderme supérieur et le dessous des feuilles), les cellules de garde produisent l’ouverture de la stomie. Les cellules de garde ont la capacité de capturer et d’intégrer de multiples stimuli internes (chimiques) et externes (environnementaux) tels que la lumière, la concentration de CO 2 et la température, qui sont les signaux environnementaux dominants pour le contrôle des mouvements stomatiques.
Aspects clés des stomies
- Parmi les facteurs qui contrôlent l’ouverture et la fermeture des stomates figurent la concentration de CO 2 à l’intérieur des feuilles, l’humidité atmosphérique, le potentiel hydrique de la feuille, la température et le vent.
- Les stomates jouent un rôle important dans les échanges gazeux, tant dans le processus de photosynthèse que dans la respiration et la transpiration (utilisation efficace de l’eau dans la plante).
- Les stomates sont responsables de la perte d’eau lors de la transpiration dans différentes conditions environnementales, et elle est régulée par le mécanisme d’action des cellules occlusives avec des mouvements d’ouverture et de fermeture des stomates, ajustant ainsi l’apport d’eau. Les facteurs environnementaux déclenchent les signaux hormonaux qui dirigent ce type de processus physiologique dans la plante.
- La répartition des stomates dans l’épiderme est variable et dépend des espèces végétales. Les conditions environnementales influencent clairement la distribution des stomates, par exemple une espèce dans des conditions environnementales à forte radiation solaire ou luminosité aura le plus grand nombre de stomates sur la face supérieure des feuilles.
police de caractères
Metcalfe, C.R. et L. Chalk. 1979. Anatomie des dicotylédones . Tome 1. Clarendon Press Oxford.
Roth, Ingrid. 1976. Anatomie des plantes supérieures . Editions de la bibliothèque, Caracas, UCV- Editions de la bibliothèque.